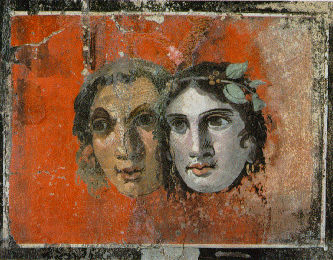
Sur le vif - Samedi 30.01.16 - 17.36h
« Ma comédie est faite, car l’intrigue est bâtie. Il faut juste ajouter les vers ». Le grand Ménandre, le père de la Comédie Nouvelle, au IVème siècle avant notre ère, cité ici par Plutarque, aurait-il fait un bon député PLR au Grand Conseil genevois ? Question difficile. Quand on scrute la genèse de l’acceptation, hier soir, par 58 voix, 29 non et 9 abstentions, des 45 millions de part cantonale pour la Nouvelle Comédie, on se dit que seul un dramaturge de la plus grande verve athénienne aurait pu produire un tel enchaînement de positions contraires, pour finalement se terminer, deus ex machina, par une issue heureuse.
Nouvelle Comédie, ou Comédie Nouvelle ? Pour tout savoir sur la seconde, lire absolument « Dans les marges de Ménandre », de mon ancien professeur André Hurst, publié l’automne dernier chez Droz, et que nous évoquerons sans tarder avec l’auteur sur mon plateau. Devant l’Histoire, pour la Comédie grecque, c’est le grand rival de son prédécesseur Aristophane, auquel Plutarque, par exemple, le préférait.
« Ma comédie est faite, l’intrigue est bâtie ». Un parti charnière, le PLR. Le protagoniste, Frédéric Hohl, tel Pénélope, tisse son rapport de majorité le jour, pour le défaire la nuit. Des mois passés à nous répéter que le projet coûte décidément trop cher. Noël arrive, le bœuf et l’âne passent, puis l’Epiphanie, quelque myrrhe et quelque encens pour honorer l’An neuf, et voilà qu’hier, miracle, le parti fusionné, malgré des abstentions, donne son aval à un projet qu’il semblait bouder.
Nouvelle Comédie, ou Comédie Nouvelle ? Comme chez Ménandre, il s’est passé quelque chose d’invisible au spectateur. Tenez, chez le grand auteur grec, comme plus tard chez Plaute, Térence, et notre Comédie à nous, surgit souvent un jumeau. Docteur Frédéric, Mister Hohl. Docteur Cyril, Mister Hélène. Par le miracle d’une gémellité, le cours des choses se renverse. Un mariage est possible. Le pauvre devient riche. L’avenir s’éclaircit. Nouvelle Comédie, ou Comédie Nouvelle ?
Comme chez Ménandre, comme chez Plaute ou Marivaux, on laisse entendre que d’autres personnages, hors du plateau, ourdissent. Des dieux ? Docteur François ? Docteur Sami ? Comme chez Ménandre, comme chez Goldoni, on passe par un moment, dans le cœur de la pièce, où plus personne n’y comprend rien. Les maîtres sont valets, les jumeaux se confondent, le destin se joue de tous. Alors, intervient l’un des mots les plus laids de la langue française : désenchevêtrement. Une saloperie d’hexasyllabe, avec une seule voyelle, le « e », six fois recommencée. Les lettres, aussi, se jumellent, se marient, font diphtongues, nous soufflent de fausses pistes. D’un mécène l’autre, de la Ville au Canton, il paraîtrait qu’on se refile l’enjeu, sur la durée, en maquignonnage avec d’autres. Secrets de coulisses, Docteur François, Mister Sami. Sabots d'Hélène.
Au final, une issue heureuse. Il semble que les manants n’aient même pas l’idée de lancer un référendum. L’essentiel s’est passé dans une opacité de coulisses, mais nul ne semble en souffrir exagérément. On se dit sans doute qu’il y a déjà le Musée, et que deux psychodrames culturels, ça ferait peut-être trop. Alors, Nouvelle Comédie ! Et pour la première pièce de la première Saison, je suggère une Comédie Nouvelle. Avec des maîtres, des valets, des jumeaux. Et quelque part, larrons en foire, ricanant de leur bon coup, Docteur Sami, Mister François.
Pascal Décaillet

