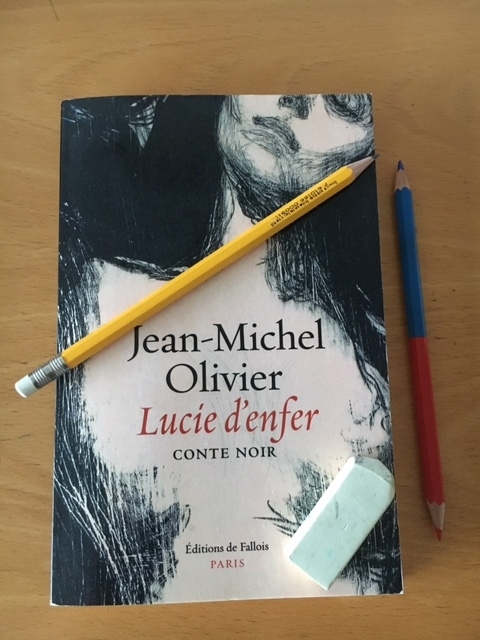Notes de lecture - Vendredi 22.02.19 - 18.12h
La ruine allemande, depuis l’enfance, me fascine. Il y a plus de cinquante ans, dans les années soixante, je m’étais retrouvé avec ma famille à Lübeck, il y avait des trous d’obus dans la façade d’une église luthérienne en briques rouges, le guide nous avait dit : « C’est la Seconde Guerre mondiale. Ou peut-être les Suédois, lors de la Guerre de Trente Ans ». De 1648 à 1945, les deux grandes destructions, totales, des Allemagnes, le brave homme s’octroyait une marge d’erreur de trois siècles !
Je n’ai pas connu la ruine allemande de 1648, sinon à travers le saisissant Simplicius Simplicissimus, publié en 1659 par le grand romancier Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1622-1676), l’un des rares narrateurs allemands émergeant du néant laissé dans les Allemagnes par la Guerre de Trente Ans : il faudra attendre le dix-huitième siècle, celui de Bach, Haendel, Beethoven et Frédéric II, celui de l’Aufklärung, puis du Sturm und Drang, celui de Kant, Hegel, Goethe, Schiller et Hölderlin, pour que renaisse l’Allemagne, au milieu des décombres. Cette renaissance, sublime et fracassante, sera celle du Phénix.
Je n’ai pas connu, non plus, la destruction de 1945, n’étant né que treize ans après. Mais j’en ai recueilli les innombrables récits de témoins, notamment les gens chez qui j’ai vécu, un quart de siècle plus tard. D’où l’intérêt saisissant que vient de représenter, pour moi, la lecture de cet « Automne allemand », du journaliste et écrivain suédois Stig Dagerman, l’un des phares de la littérature scandinave dans les années 40, né en 1923, et qui s’est donné la mort à 31 ans, en 1954. J’ai lu ce livre sous le soleil de Provence, en ce miraculeux février où la vigne, épurée comme un vestige grec, offerte au ciel et promise à l’élévation, attend la vie, pour en renouveler le cycle.
Cet Automne allemand, de Dagerman, c’est l’Allemagne, An 1. A s’y méprendre, il ressemble à l’Année Zéro. La guerre aérienne des Anglais et des Américains contre l’Allemagne, de 1942 à 1945, fut avant tout une guerre contre la ville allemande. La plupart furent détruites, certaines totalement, alors que des milliers de villages sont demeurés intacts. Pour l’Anglais, il fallait venger Coventry (bombardement par la Luftwaffe, la nuit du 14 au 15 novembre 1940), ce fut fait au centuple, voire mille fois. Pour l’Américain, il fallait tapisser les populations urbaines de bombes, pour démoraliser les civils. La ville allemande demeurera détruite pendant des années : il faudra jusqu’au début des années 50 pour simplement déblayer les ruines, puis, très rapidement, on reconstruira, souvent fort mal, hélas : la Vieille Allemagne est bien morte en 1945.
En 1946, le jeune Stig Dagerman, auteur prodige de 23 ans (il avait déjà publié « Le Serpent », en 1945), erre comme journaliste, plusieurs semaines, au milieu de l’Allemagne en ruines. Le pays n’existe plus, il n’y a pas d’Etat entre 1945 et 1949, les Allemagnes sont partagées entre quatre zones d’occupation (Soviétiques, Américains, Britanniques, Français), il n’y a rien à manger, des millions de soldats allemands sont encore prisonniers de guerre (notamment en Russie), les routes, les voies ferrées, sont coupées. Et, pour tout couronner, des millions d’Allemands, implantés à l’Est depuis des générations, affluent dans la « Mère-Patrie » comme réfugiés : dans une Allemagne détruite, vaincue, sans nourriture, tant les conditions d’approvisionnement sont difficiles !
Cette Allemagne de l’An 1, Stig Dagerman nous en brosse un portrait époustouflant. Il se promène dans les caves de Hambourg, ville totalement détruite lors des terribles bombardements britanniques (surtout), mais aussi américains, de juillet et août 1943, 45'000 morts, l’Opération Gomorrhe, une horreur absolue, la deuxième plus grande dévastation d’une population civile urbaine allemande après celle de Dresde, par les Anglais, les 13 et 14 février 1945. Hambourg, c’était deux ans plus tôt, deux ans avant la défaite : les survivants, de 1943 à 1945, erraient dans la ruine allemande, non sous l’Occupation alliée, mais sous le Troisième Reich lui-même ! Alors que la Wehrmacht, loin d’être vaincue, se battait encore sur tous les fronts d’Europe. Même le génial Bertolt Brecht n’aurait pas imaginé une telle situation.
A Hambourg, Dagerman se promène au milieu des caves inondées, où se terrent les civils. Une seule préoccupation : manger. Une pomme de terre est un paradis. Manger, et puis trouver du charbon. On a beau se trouver dans le premier pays producteur d’Europe, qui vient de perdre la Silésie (conquise deux siècles plus tôt par Frédéric II), et le contrôle de la Ruhr, la denrée est rare, précieuse, vitale. Les conditions de vie sont épouvantables. L’occupant britannique se désintéresse totalement des populations civiles allemandes, il faut venger Coventry, il faut qu’ils paient. A lire Dagerman, on se dit qu’il y en aura pour des décennies : dix à quinze ans plus tard, Hambourg, comme toutes les villes allemandes, sera de nouveau debout. Je me souviens de ma première visite familiale à Hambourg, début juillet 1968 : on n’y voyait presque plus aucune trace de destruction.
Dagerman visite aussi Munich. Il en profite pour nous décrire la situation ahurissante dans laquelle se trouvent les passagers ferroviaires, et à quel point tout trajet interurbain en train, dans cette Allemagne de 1946, est une aventure proche de l’impossible. Dans la capitale bavaroise, il assiste au discours d’un revenant, le Docteur Kurt Schumacher (1895-1952), chef des sociaux-démocrates allemands, un ancien de la République de Weimar qui a passé la plus grande partie du Troisième Reich à Dachau : le seul fait qu’un tel homme ait survécu au régime nazi constitue, en soi, un miracle. A Munich, Königsplatz, le chef du SPD tient un discours très national, exigeant (en 1946 !) la restitution de la Sarre, de la Prusse-Orientale, de la Ruhr et de la Silésie. Et notre Dagerman, écrivain et reporter suédois de 23 ans, est là, au milieu des ruines munichoises. Il écoute.
Il y a aussi Berlin, dans cet Automne allemand de Dagerman. Il y a le terrible Bois des pendus, où avaient été exécutés, un peu plus d’un an auparavant, les tout jeunes conscrits des derniers combats, des gamins de seize ans, qui s’étaient montrés peu enthousiastes à l’idée d’offrir leur vie, tout juste naissante, au Reich agonisant. Et puis, il y a la dénazification, ou du moins ce qui en tient lieu : cela s’appelle les « Spruchkammern » les Chambres chargées d’enquêter sur le passé (tout récent !) de centaines de milliers d’Allemands. Avec brio, Dagerman nous montre à quel point cela (hormis les grands procès, orchestrés pour la presse) fut bâclé, certains juges s’excusant auprès des accusés : « Nous ne faisons cela que parce que l’occupant allié nous y oblige ». En 1946, par miracle, plus aucun Allemand ne se souvient d’avoir été nazi, ou alors vraiment par obligation. Nombre de vrais criminels passent entre les gouttes. Le vrai travail de mémoire ne se fera que dans les années 80.
Il y a aussi de terribles anecdotes, comme la Bavière qui renvoie en Rhénanie, ou dans la Ruhr, ou à Hambourg, contre leur gré, les réfugiés des terribles bombardements des années 42 à 45. La Bavière, paysanne, productrice de vivres, ne manque pas de ressources. Elle méprise le reste de l’Allemagne. Elle renvoie chez eux, dans des trains bondés qu’aucune gare ne veut accueillir, des réfugiés internes à l’Allemagne : des Allemands renvoient des Allemands. Passionné d’Histoire allemande, je ne connaissais pas cet épisode.
« Automne allemand », de Stig Dagerman, à la fois reportage journalistique et œuvre littéraire, constitue un témoignage majeur. A recommander à tous ceux qui, pour approcher la vérité historique de l’immédiat après-guerre allemand, loin des clichés ou des idées reçues, veulent croire à la multiplicité des témoignages, complexes, parfois contradictoires, comme indispensable matériau à l’élaboration patiente d’une mosaïque de la compréhension. A ce titre, Automne allemand n’est pas seulement une réflexion sur l’An 1 de l’Allemagne, mais sur l’Histoire elle-même. Comme chemin de connaissance. Et d’incessante remise en question du réel. A tous, excellente lecture !
Pascal Décaillet
*** Automne allemand. Par Stig Dagerman. Traduit du suédois par Philippe Bouquet. Actes Sud, 1980. 165 pages.