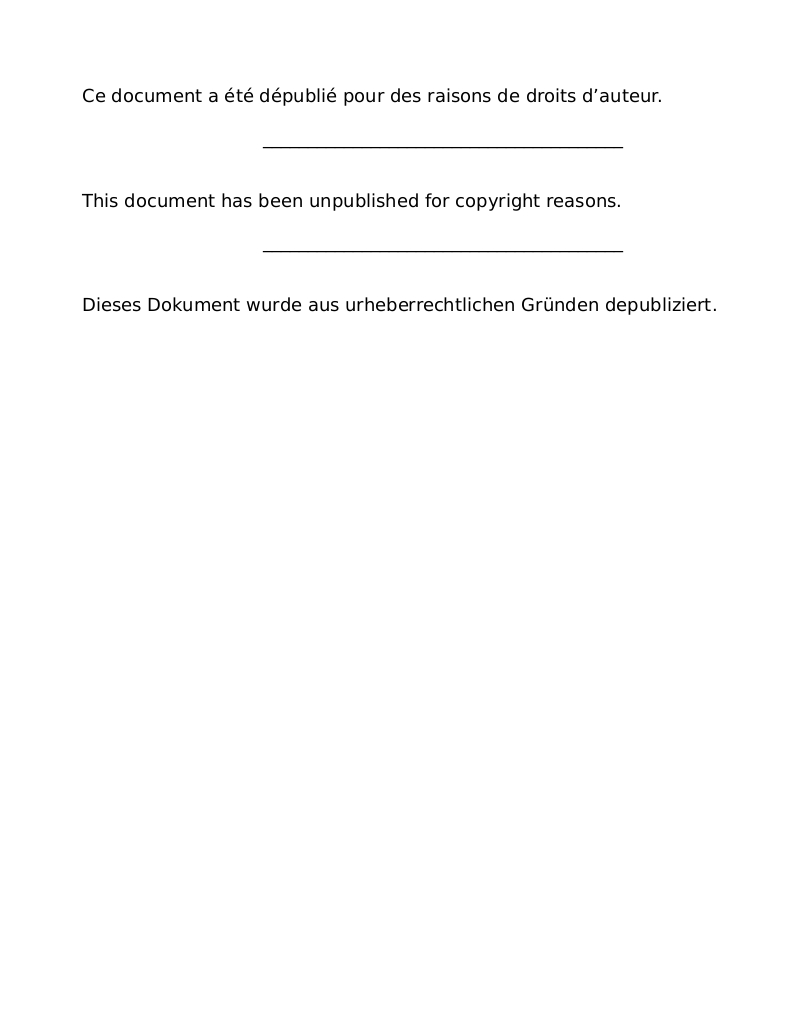Sur le vif - Lundi 21.12.15 - 15.42h
« Culture alternative » : que signifient ces deux mots ? La culture n’est-elle pas, par essence, le lieu d’une alternance, d’une transgression du convenable ? On saccage le Grand Théâtre, parce qu’il serait le temple de la culture bourgeoise, chouchouté par ceux qui stipendient, épargné par ceux qui coupent. On s’en prend à ses murs, on les peinturlure, on les profane. Bref, on défèque sur l’institution. Mais quid de l’essentiel, les œuvres ?
Entre Wagner composant la Walkyrie, ou Strauss travaillant sur un livret d’Hofmannsthal, ou Britten, ou Bartók, dans l’incroyable aventure de leur invention formelle, quel point commun ? Lequel, si ce n’est d’avoir, chacun face à l’ordre de son temps, face au registre du convenable dans sa génération, permis l’éclatement d’une forme, son évolution vers « autre chose ». Nous invitant au voyage vers l’alternance, ne sont-ils pas ontologiquement « alternatifs » ?
Alors, les casseurs s’attaquent aux murs, les profanent. On prouve quoi ? Sa colère, son dégoût, sa révolte. On se met à dos l’ensemble du corps social, modérément porté sur ce genre d’éruption. On n’aura réussi qu’à salir des édifices, se faire haïr du badaud, retourner contre soi la violence engendrée. Mais on n’aura touché ni à Wagner, ni à Bartók, ni à Britten. Dans l’ordre de « l’alternance », cette irruption de l’inattendu dans les matrices, on ne se sera signalé que par la capacité à salir. C’est peu.
Que fait la bourgeoisie, depuis deux siècles ? Elle a tendance à rejeter, de leur vivant, les créateurs qui font vraiment évoluer la forme. Puis, ces derniers disparus, ayant pris conscience avec une ou deux générations de retard de leur génie, elle brille dans l’art de les récupérer. Alors, dans des écrins de luxe, elle les enferme, les illumine, tente une œuvre de résurrection. Les saccageurs, samedi soir à la Place Neuve, ont attaqué l’écrin. Rien d’autre. C’est peu. C’est dérisoire.
Oui, la bourgeoisie récupère. On lit maintenant Genet, Koltès, Heiner Müller, Paul Celan, avec les élèves, on ne les lisait pas tant de leur vivant. On emmène des classes écouter les ultimes Quatuors de Beethoven, considérés comme dissonants par ses contemporains. On lit Rimbaud dans toutes les écoles francophones du monde, on ne le lisait guère entre 1870 (ses premiers poèmes) et sa mort, en 1891.
Et les lieux officiellement intitulés « alternatifs » ? Nous préparent-ils ce qui, demain, par d’autres qui aujourd’hui les méprisent et les rejettent, sera mis en écrin ? C’est possible. Pour ma part, en tout cas, je leur en donne volontiers crédit. Mais ne soyons pas dupes : la transgression, dans l’ordre de l’art, ne provient ni de l’étiquette « alternative » d’un local, ni d’une ambition révolutionnaire sociale, ni d’ailleurs conservatrice : elle ne surgit que d’un travail sur la forme, puissant, ancré, propre à chaque destin de créateur. La matrice politique, sur ces enjeux-là, n’a qu’une influence modeste, pour peu qu’elle en ait une.
Alors, si « l’alternatif » ne se démarque pas sur son efficacité dans la transgression formelle, quel sens peut-il avoir ? Ne pas dépendre des forces de l’Argent ? Noble ambition. Mais dans ce cas, pourquoi s’en aller quérir les fonds publics ? Si on se met à devoir sa survie, peu ou prou, à ces derniers, on doit aussi accepter les obligations qui en découlent : celui qui paye commande, c’était valable au temps des mécènes, ça le demeure en celui de la citoyenneté bourgeoise, celle qui redistribue l’impôt.
Au final, si « l’altérité » ne se révèle que comme une duperie dans l’ordre de la forme, et une illusion d’indépendance dans celui du financement, on peine à percevoir en elle autre chose qu’une singularité auto-proclamée. Ce que chacun d’entre nous, après tout, a bien le droit de faire, si ça l’amuse. Celui qu’il n’a pas, c’est de prendre en otage cette cause pour s’en aller saccager les édifices et les vitrines d’une ville. Cette transgression-là n’appelle qu’une réponse : celle de la loi, dans sa rigueur.
Pascal Décaillet