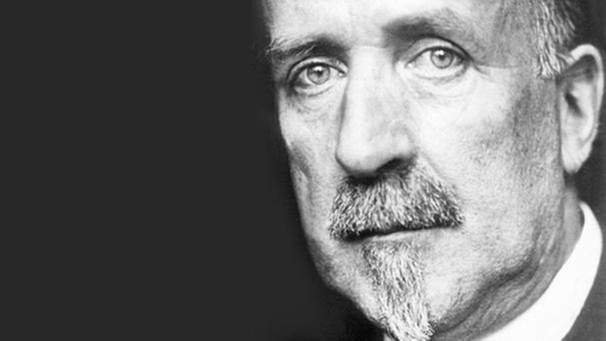L’Histoire allemande en 144 tableaux – No 13 – De 1933, date de l’arrivée de Hitler au pouvoir, jusqu’à 1940, défaite de la France face à l’Allemagne, voire plus tard encore dans la guerre (1942, occupation de la zone sud), des dizaines d’écrivains allemands, en exil, se sont regroupés à Sanary-sur-Mer, petit village de pêcheurs sur la côte varoise. Parmi eux, les plus grands noms de la littérature allemande ou autrichienne au vingtième siècle : Bertolt Brecht, Thomas Mann, Stefan Zweig. Si un jour, vous passez par Sanary, pensez à eux.
Lorsque l’exil prend la parure du bleu, celui de mer, celui d’azur, sous la tranquille compagnie des palmiers, dans un village de pêcheurs de la côte varoise, à quoi donc peut bien penser l’exilé ? La douceur du paysage vient-elle atténuer sa douleur ? Ou l’Allemagne natale l’occupe-t-elle tout entier ? Je me suis fait cette réflexion il y a quelques années, en arpentant les rues si douces de Sanary-sur-Mer, dont tout le monde, peut-être, ne sait pas qu’elle fut, de 1933 à 1940, la « capitale de la littérature allemande », selon l’expression de Ludwig Marcuse (1894-1971), l’un des exilés, justement, parmi les plus célèbres.
Capitale de quoi ? De la douleur ? De la nostalgie ? De la tristesse, loin du pays ? La splendeur de la carte postale, l’îlot de quiétude, la qualité des rencontres, dans les villas privées ou sur les terrasses des cafés, quelle espèce de rôle tout cela peut-il bien tenir dans l’âme d’un écrivain de génie, arraché à sa patrie ? L’âme d’un Thomas Mann, d’un Bertolt Brecht, d’un Stefan Zweig ? D’ailleurs, la patrie d’un écrivain, où est-elle ? Là où il réside ? Là d’où il vient ? Là où il va ? Je crois qu’à Sanary, Thomas Mann devait se sentir plus que jamais de Lübeck, et Brecht, rêver dans les mots souabes de son enfance, lui le surdoué de la syllabe : il paraît qu’à la guitare, à Sanary, il entonnait des chansons contre Hitler.
Cette histoire-là, c’est celle de la crème de la littérature allemande qui, dès l’année 1933, pas directement après le 30 janvier (accession de Hitler au pouvoir), mais après les autodafés du 10 mai, prend le chemin de l’exil. Ce jour-là, dans une mise en scène orchestrée au niveau national par le pouvoir nazi, on avait jeté au bûcher tous les livres dont l’esprit était jugé anti-allemand. On allait réaliser l’éclatante prophétie du poète Heinrich Heine (1797-1856), « Là où on brûle les livres, on finira par brûler des hommes ». Alors, les plus grands écrivains allemands se sont mis à partir.
Mais pourquoi diable Sanary ? Une affaire de filière : un ou deux commencent par s’y installer, cela se sait, les autres affluent à leur tour. Parmi les premiers, il y eut Lion Feuchtwanger (1884-1958), qui y demeurera de 1933 à 1940. Mais aussi, Thomas Mann, qui s’établit dès le 12 juin à la Villa Tranquille. Autour de lui, gravitera toute la dynastie dans la station varoise : son épouse Katja, son frère Heinrich (cf. notre dernier épisode, no 12), ses enfants Erika, Klaus, Golo. Et très vite, Sanary-sur-Mer deviendra « la capitale de la littérature allemande » en exil.
Mais l’Histoire est toujours là, qui rattrape les rêves d’azur. Septembre 39, la guerre. Mai-juin 40, la vraie, pour la France, et au bout de six semaines, la plus grande défaite de son Histoire. Les exilés de Sanary prennent le chemin d’un exil plus lointain, Espagne, Portugal, États-Unis. Certains sont internés. L’écrivain Hans Arno Joachim finira à Auschwitz, et n’en reviendra pas. La France, celle de la Drôle de Guerre (septembre 39 - mai 40), se méfie des Allemands : qu’ils soient de grands esprits exilés, opposants au régime, ne compte guère ; l’internement est la règle. Et puis, de toute façon, en novembre 1942, la zone libre est occupée, les Allemands fortifient Sanary contre un éventuel débarquement. Il n’y a plus ni rêve, ni villégiature, il n’y a plus que la guerre.
Reste que, pendant sept ans, les pins et les palmiers de Sanary, les murs de pierre des villas de maîtres, les terrasses des cafés du bord de mer ont dû entendre d’époustouflantes conversations. Des auteurs comme Feuchtwanger ont vécu sur la côte varoise des moments prolifiques de leur carrière. Au cours de ces années trente, on y aura vu défiler le plus grand dramaturge du vingtième siècle (Brecht), l’un des plus grands romanciers de la littérature mondiale (Thomas Mann), le bouleversant Stefan Zweig, mais aussi Joseph Roth, Franz Werfel et Alma Mahler, et tant d’autres. Sanary, c’est comme si l’âme profonde de l’Allemagne, quelques années, était venue s’accrocher aux rives de la mer bleue.
Mais Thomas Mann, le soir, de blanc vêtu, l’été, se laissait-il prendre par la magie de cet azur ? Ou son esprit, plus que jamais, ne revenait-il pas sur une autre côte ? Celle, lointaine, de Lübeck. Celle de sa Baltique natale. Celles des Buddenbrooks ? Cela, le saurons-nous jamais ? Seuls les arbres centenaires de Sanary, peut-être, en conserveront le secret.
Pascal Décaillet
*** L'Histoire allemande en 144 tableaux, c'est une série non chronologique, revenant sur 144 moments forts entre la traduction de la Bible par Luther (1522-1534) et aujourd'hui.
Prochain épisode : Blücher, le Maréchal Vorwärts !