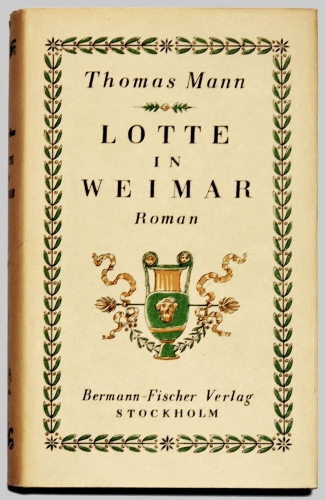Sur le vif - Mardi 03.06.25 - 16.18h
Au début des années 1980, je passais mes soirées au CAC, rue Voltaire, où le maître des lieux, le fantastique passeur Rui Nogueira, nous initiait à des films sublimes, loin des salles grand public et des circuits commerciaux. Loin, surtout, de tout souci de "coller à l'actualité", comme disent les journalistes.
Le CAC ne présentait pas des films en fonction de leur sortie récente, ni de leur retentissement dans la presse. Non, Nogueira nous diffusait des "cycles". Le cycle Cassavetes, qui m'avait tant impressionné. Le cycle Douglas Sirk, dont une séance en présence de l'auteur, en présentation de sa célèbre adaptation du chef d’œuvre d'Erich Maria Remarque. Le cycle Marguerite Duras. Le cycle homosexualité, bouleversant. Et puis, au tout début des années 80, alors que l'auteur vivait encore, le cycle Fassbinder. Celui-là m'avait littéralement emporté.
Rainer Werner Fassbinder est né le 31 mai 1945, trois semaines et deux jours après la défaite. Il est mort à Munich le 10 juin 1982. Il venait d'avoir 37 ans. Il laisse une oeuvre unique, impressionnante au théâtre comme au cinéma. Il y avait bien sûr un cinéma allemand d'après-guerre avant lui, dont les films de Schroeter autour de Maria Callas, et cet incroyable "Hitler" de Syberberg, qui n'est ni documentaire, ni fiction, il dure sept heures, j'étais justement allé le voir avec un ami. Chez qui ? Chez Nogueira, bien sûr !
Il y avait un cinéma allemand d'après-guerre avant lui, mais comment dire ? Ce phénomène autodidacte, bourreau de travail, déménageur d'enthousiasmes, qu'était Fassbinder, a révolutionné un moment clef du cinéma allemand, qui était si vivace avant la guerre, dès l'époque du muet. Mais dans l'après-guerre, le cinéma allemand avait connu un moment d'assoupissement, c'était le temps du non-dit.
Que s'est-il passé ? Disons simplement que Fassbinder a réveillé les mémoires allemandes enfouies. Jamais pour moraliser. Jamais au nom d'un "devoir de mémoire", d'autres s'en sont chargés, il le fallait bien sûr. Non, Fassbinder, lui, nous raconte la vie des Allemands, la vie d'un couple, d'une famille, sur fond de braise et de feu. C'est un dramaturge-né, sur les planches comme à l'écran. "Die bitteren Tränen der Petra von Kant", montées à la Comédie avec une magnifique sensibilité il y a longtemps, par Anne Bisang, c'est lui, texte, dramaturgie, réalisation pour l'écran. Fassbinder, artiste total.
Pour les 80 ans de Fassbinder, nous dirons quelques mots, en direct ce soir 19h, aux Yeux dans les Yeux, avec Laetitia Guinand. J'aurais voulu avoir Nogueira. Lui aussi, aurait adoré venir, mais il est retenu par un problème de santé. Mais je penserai à lui ce soir, comme je pense à lui chaque fois que je revois un grand film, Visconti, Fellini, Anonioni, Pasolini, Bergman, Preminger.
Fassbinder fut un éveilleur de consciences. Nogueira est un guide. Avant chaque film, au CAC de la rue Voltaire, il nous disait quelques mots, en introduction. C'était court, anecdotique, drôle, prodigieusement informatif. Je n'ai rien oublié. Ni lui, ni Fassbinder. Je n'oublie jamais rien de ce qui compte.
Pascal Décaillet