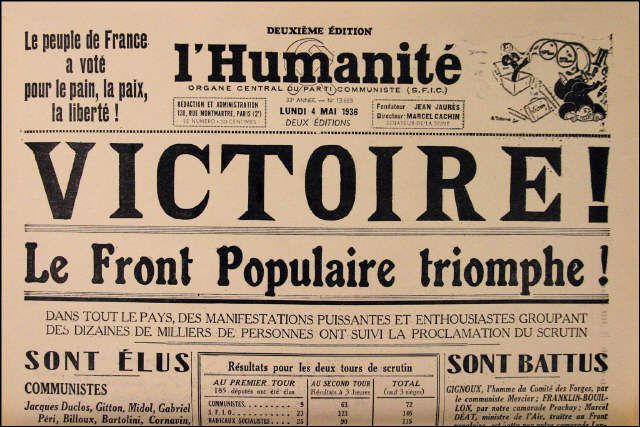Commentaire publié dans GHI - Mercredi 21.06.17
Un fusible. C’est par ce mot que nous avions qualifié ici même, il y a un an, le chef des opérations de la Police genevoise, Christian Cudré-Mauroux. A cette époque, les voix n’étaient pas innombrables, pour défendre l’homme. Il y eut même quelques belles prises de position pour justifier la véritable persécution que le Conseil d’Etat exerçait sur ce grand policier, trente ans de loyaux services, sur les épaules duquel on avait voulu faire porter tous les maux, en lien avec la manifestation sauvage du 19 décembre 2015. Pendant près d’un an, l’affaire est demeurée figée. Et voilà que ce vendredi 16 juin, par temps magnifique et tout le monde se préparant à savourer le week-end, un communiqué de la Cour de Justice était publié, réhabilitant le policier.
Le vendredi 16, cette publication, et pas, par exemple, le jeudi 15. Amusant, non ? Le soir de ce jeudi, se déroulait à Veyrier l’Assemblée des délégués du PLR, qui désignait son ticket pour le Conseil d’Etat 2018. Elu en tête du trio de candidats, avec Nathalie Fontanet et Alexandre de Senarclens, un certain… Pierre Maudet, ministre de tutelle de la Police. Eût-il obtenu une aussi bonne désignation, si la Cour avait publié son arrêt (datant du 6 juin) 24 heures plus tôt, donc AVANT l’Assemblée de Veyrier ? Oui, je sais ce que vous allez me répondre : séparation des pouvoirs, et patati, et patata. Fort bien. Allons-y pour la séparation.
Toujours est-il que voilà un homme d’honneur réhabilité. La Cour annule, purement et simplement, l’arrêté du Conseil d’Etat du 22 juin 2016, qui dégradait l’officier de lieutenant-colonel à major, sanction totalement infamante dans le signal qu’elle donne, avec son côté Dreyfus, Cour des Invalides, 5 janvier 1895, sans compter la réduction de traitement. Elle estime, notamment, que « le recourant n’avait pas menti à sa hiérarchie, ni ne lui avait dissimulé de documents ou d’autres renseignements pertinents ». En clair, elle s’inscrit totalement en faux contre les arguments du Conseil d’Etat, qui avait cloué publiquement au pilori l’un des serviteurs les plus fidèles de la Police genevoise.
Pire : ce même vendredi 16 juin, à peine la Cour avait publié son arrêt, le Département Maudet s’empressait de réagir (à une décision de justice !), rappelant qu’il s’était appuyé sur le rapport administratif d’un ancien juge. Là encore, l’autorité de tutelle se défausse de sa responsabilité politique, car enfin, l’humiliante dégradation, c’est lui qui doit en assumer la décision. Dans le même communiqué, il n’exclut pas de recourir lui-même contre l’arrêt de la Cour, ce qui est certes son droit, mais accentue le signal de « mauvais perdant ». En conclusion, dans cette case éditoriale que nous tenons depuis six ans et où nous n’avons pas l’habitude de distiller la langue de bois, nous dirons que le Conseil d’Etat, d’un bout à l’autre de cette affaire, a fait tout faux, s’est montré arrogant, a dissimulé sa propre responsabilité pour faire fonctionner des fusibles. On a dû connaître, ici ou là, meilleure gouvernance. Quant à M. Cudré-Mauroux, nous lui faisons part publiquement de notre respect et de notre considération.
Pascal Décaillet