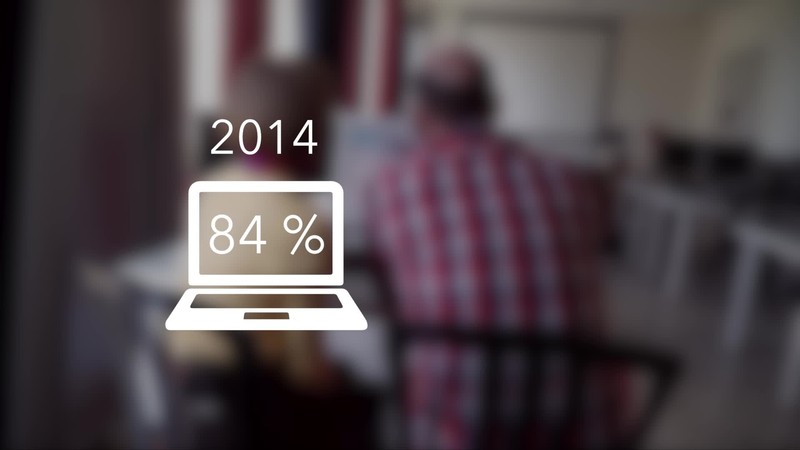
Commentaire publié dans GHI - Mercredi 27.09.17
Il y a eu Thomas Bläsi, sur le plateau de Genève à chaud, en peine campagne de Pierre Maudet pour le Conseil fédéral. Et puis, dans les mêmes circonstances, il y a eu deux fois Marc Fuhrmann, président de l’UDC genevoise, face à son homologue PLR Alexandre de Senarclens. Tout cela, à quelques jours d’intervalle, seulement. Que s’est-il passé ? Des flèches au curare, décochées par l’UDC, contre le PLR à Genève. Que les tireurs fussent, au civil, des gentlemen aussi courtois que le débonnaire pharmacien Bläsi ou le très civil Fuhrmann, ne change rien à l’affaire. Il y a, clairement, une rogne de l’UDC contre le PLR, au bout du lac. Comme si, une goutte d’eau ayant fait déborder le vase, tout devait maintenant sortir, s’écouler, s’épancher. Comme si les esprits, trop longtemps contenus, avaient maintenant besoin de fulminer. Crever l’abcès.
La goutte d’eau, c’est la campagne Maudet pour la plus haute marche du podium, en Suisse. On sait à quel point le candidat genevois a été accueilli froidement, lors des auditions, par le groupe UDC des Chambres fédérales : près d’un tiers de l’Assemblée fédérale, et une seule voix pour le candidat de Genève ! C’est le tournant de la campagne, l’irruption de la Statue du Commandeur, celle d’une Vieille Suisse, chargée d’Histoire, conservatrice, attachée à des traditions locales, nationales et populaires, qui n’est pas nécessairement très sensible aux accents d’urbanité, d’Europe, d’incantations numériques et d’armée réduite à sa portion congrue de la campagne Maudet. Le choc de deux univers. Avec, à la clef, une sanction.
Alors, ce rejet du candidat Maudet par l’UDC, aux Chambres fédérales, on en parle à Genève, on en débat. Et c’est là que le gentil apothicaire et le placide président décident de passer à l’attaque. Face au numéro 1 du PLR genevois, ils évoquent le comportement méprisant de ce parti à leur endroit. Pierre Maudet, sur divers projets discutés au Grand Conseil, ne leur accorderait aucune place, aucune écoute, comme s’ils n’existaient pas. Du coup, on voudra bien comprendre qu’ils ne soient pas surexcités d’envie à le voir devenir conseiller fédéral. Tout cela, chacun avec ses mots, MM Bläsi et Fuhrmann le disent. En face, Alexandre de Senarclens, maître de lui-même, encaisse, avec juste la crispation d’un demi-sourire. Plus qu’il n’en faut pour faire éclater aux yeux du public un état de tension – pour user d’un mot poli – entre ces deux partis de la droite genevoise.
Le discours tenu au PLR par l’UDC, c’est celui d’une humiliation ressentie. Il est survenu en double période électorale, celle de la campagne Maudet pour Berne (désormais terminée, comme on sait), mais surtout celle de la pré-campagne pour les élections cantonales du printemps 2018. Il a des accents de théâtre, au mieux le surgissement d’Elvire dans Dom Juan, au pire le soupir éconduit d’une soubrette de boulevard, mais son enjeu est réel. Il démasque une face longtemps cachée. Il révèle. Pour l’heure, rien n’est réglé. Peut-être, l’amorce d’un affranchissement. Et puis, peut-être pas. Comme au théâtre, décidément. A suivre, dès le prochain épisode.
Pascal Décaillet
