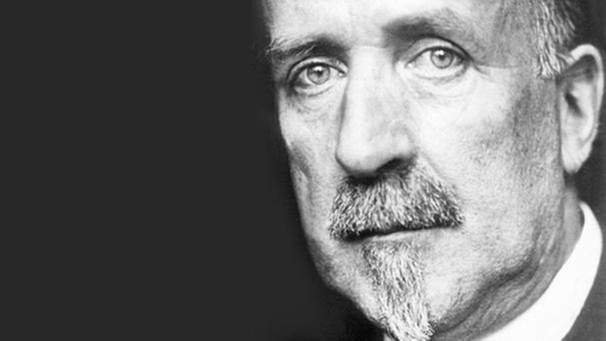L'Histoire allemande en 144 tableaux - No 11 – Leipzig, 16 au 19 octobre 1813 : un choc colossal. Trois Rois et trois Empereurs. Au final, une défaite pour Napoléon. Et pour les Allemagnes, le début du renouveau.
C’est une bataille capitale, sans doute la plus importante des guerres napoléoniennes. Pourtant, à part dans l’historiographie allemande, elle est peu connue du grand public : moins que le soleil d’Austerlitz (2 décembre 1805), moins que la morne plaine de Waterloo (18 juin 1815). Mais les Allemands, eux, la connaissent : ils ont quelques raisons de s’en souvenir.
D’abord, parce que ce choc monumental de plusieurs armées s’est déroulé chez eux, dans la ville qui était celle de Bach et qui allait devenir celle de Wagner (il y est né le 22 mai, cinq mois plus tôt, et son père mourra des séquelles du typhus, contracté au moment de la bataille). Surtout, parce que Leipzig marque la fin de l’occupation française, le reflux de la Grande Armée vers son territoire national (pour le défendre, ce qu’elle fera admirablement en 1814), la victoire des peuples allemands libérés. D’où le surnom de Leipzig : Völkerschlacht, la Bataille des Nations. A bien des égards, on peut considérer la période 1813-1945 comme un cycle de l’Histoire allemande, celui du réveil national, des conquêtes, puis de la chute, lors de la prise de Berlin au corps à corps, maison par maison, par les Soviétiques.
L’historien Stéphane Calvet parle de la bataille des Trois Rois (Murat pour Naples, le roi de Prusse et le roi de Saxe) et des Trois Empereurs (Napoléon, le Tsar Alexandre, l’Empereur d’Autriche). Dans son livre, « Leipzig 1813, la guerre des peuples » Editions Vendémiaire, il nous livre le remarquable résultat de recherches sur le déroulement de la bataille, la violence du choc, les blessures, le rôle de l’artillerie, le sort terrible des mutilés (nous sommes bien avant Solferino). Les Allemands, pour leur part, ont beaucoup écrit sur la bataille de Leipzig, conscients de son rôle capital dans le destin de leur pays.
Leipzig, c’est la grande bataille de l’après Campagne de Russie. La Russie, la Prusse, l’Autriche, mais aussi la Suède de Bernadotte sont unies contre la France, qui, également ennemie de l’Angleterre, se trouve seule face à la puissance et la supériorité numérique de cette Sixième Coalition. Sur territoire prussien, dans les mois qui précèdent, Napoléon remporte encore des victoires (Lützen, Bautzen), mais c’est bel et bien dans la ville saxonne que va se dérouler, en automne, l’une des plus violentes confrontations de l’Histoire militaire européenne.
La bataille dure trois jours, du 16 au 19 octobre. Encore aujourd’hui, elle est étudiée dans les Ecoles militaires. Les mouvements de troupes sont complexes. Le sort (comme, deux ans plus tard, à Waterloo) ne se décide que sur le tard. Les Alliés sont en nette supériorité numérique. Les canons, innombrables. La violence de l’artillerie, incroyable. Certains font dater de Leipzig le début du concept de « guerre totale », d’autres d'Eylau (1807, la charge de cavalerie de Murat), d’autres encore bien avant. Ce qui est sûr, comme le note Stéphane Calvet, c’est que Leipzig nous fait entrer dans un nouveau type de batailles. Il parle du « crépuscule des guerres dynastiques ». Et de la naissance de guerre des peuples.
Certes, la nation en armes s’était levée dès la Révolution, en France, avec les Soldats de l’An II, mais là, ce sont tous les peuples d’Europe qui commencent à se battre pour un autre impératif que le service du prince. Dès lors, comment ne pas rattacher Leipzig 1813 aux Discours à la Nation allemande, Fichte, Université de Berlin, 1807, dont nous avons déjà parlé dans cette Série ? Et la voilà justement, cette Prusse, quittant Napoléon pour se battre avec les autres Allemands, entrant dans un dix-neuvième siècle qui sera celui de sa plus grande puissance, elle qui forgera l’unité allemande.
Reste la question des Saxons. Alliés de Napoléon, ils ont allégrement trahi l’Empereur dans la dernière phase de la bataille (au moment où le destin pouvait sourire à la Grande Armée), et l’expression, dans bien des milieux, est restée : « Saxon », comme synonyme de « traître ».
Stéphane Calvet nous montre, avec d’autres, à quel point la bataille fut terrible. Les Coalisés perdent plus d’hommes que les Français, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Le sort des blessés est terrible. On les isole dans des ghettos, ou des cimetières, les hôpitaux sont débordés, Henry Dunant et la Croix-Rouge n’existent pas encore. Les épidémies se lèvent. On se bat dans les rues. Il est même question un moment, précise toujours Calvet, de faire sauter la ville.
Au final, les Français sonnent la retraite. Ca n’est pas une capitulation, mais la Grande Armée s’en va. Le prochain enjeu, ce sera, en 1814, la Bataille de France, qui certes se soldera par le premier exil de Napoléon (île d’Elbe), mais montrera plus que jamais le génie stratégique de l’Empereur, qui promène les Alliés pendant des semaines, de Montmirail à Château-Thierry.
Mais diable, nous sommes ici dans une Série Allemagne. Pour les Prussiens, pour les Saxons, pour l’idée naissante de nation allemande, quelque chose se passe, du 16 au 19 octobre, autour de la ville de Leipzig. Oh certes,il faudra encore du temps, le Zollverein, puis, deux générations plus tard, les combats interallemands menant à l’unité, mais Leipzig sera vite considérée, du Rhin à l’Oder, comme le réveil armé des peuples. Que le lieu de ce choc titanesque fût la ville du Cantor Bach, celle où Mendelssohn le fera redécouvrir, celle de Richard Wagner, ne peut être considéré comme un simple caprice du hasard. Très vite, les Allemands y voient un signe du destin. La mère de toutes les batailles, autour de l’un des centres historiques de la culture allemande. La bataille de Leipzig, c’est peut-être, dans le destin allemand, le vrai début du dix-neuvième siècle, qui durera 101 ans, jusqu’en 1914.
Pascal Décaillet
*** L'Histoire allemande en 144 tableaux, c'est une série non chronologique, revenant sur 144 moments forts entre la traduction de la Bible par Luther (1522-1534) et aujourd'hui. Prochain épisode : Heinrich Mann, le vrai père de L'Ange Bleu.